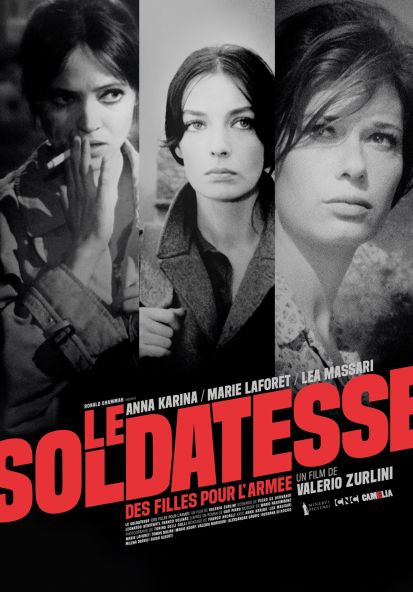"Le soldatesse n’est que le cinquième long métrage de Valerio Zurlini, et pourtant il amorce la conclusion d’une carrière marquée par les échecs critiques et commerciaux, les projets inachevés et les années de silence. Le cinéaste italien possède en effet la particularité de n’avoir réalisé seulement huit longs métrages entre 1955 et 1976, durant une période où l’industrie cinématographique italienne se caractérisait au contraire par son extraordinaire productivité. Cela s’explique en partie par son intransigeance artistique et des rapports professionnels ombrageux, qui écourtèrent une filmographie sans compromis. Zurlini est un auteur à l’univers déliquescent qui plaça la tristesse, et même le désespoir au cœur de son œuvre, brève mais brûlante.
De tous les grands cinéastes italiens, il reste le plus discret et le plus mystérieux. Le soldatesse est un film secret, sous-estimé, passé relativement inaperçu, qui mérite d’être redécouvert. Il rappelle la proximité de Zurlini avec le néo-réalisme, dont il fut l’un des principaux continuateurs. Comme Rossellini avant lui, Zurlini montre les conséquences destructrices de la Seconde Guerre mondiale sur les populations civiles, et de manière plus générale, sur la civilisation européenne.
Dans Le soldatesse, ce sont les troupes italiennes, et non allemandes, qui se livrent à des exactions et occupent la Grèce au terme d’une résistance acharnée de son armée. La différence est de taille. Zurlini fustige les crimes de l’armée italienne dans un conflit tragique et inutile motivé par l’orgueil de Mussolini qui voulait prouver sa force militaire à son allié allemand, et rêvait d’un nouvel Empire Romain qui aurait inclus la Grèce.
Il réalise ainsi l’un des rares films clairement antifascistes du cinéma italien. Zurlini confronte ses compatriotes à leur responsabilité durant la Seconde Guerre mondiale et signe un courageux « mea culpa ». Le cinéaste attribuera l’insuccès du film à sa dénonciation de la bonne conscience, de l’oubli volontaire et de la victimisation de l’Italie de l’après-guerre. Il y démontre l’implication directe des chemises noires dans des massacres commis en Grèce.